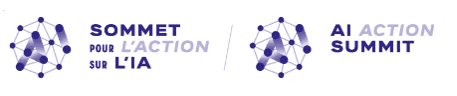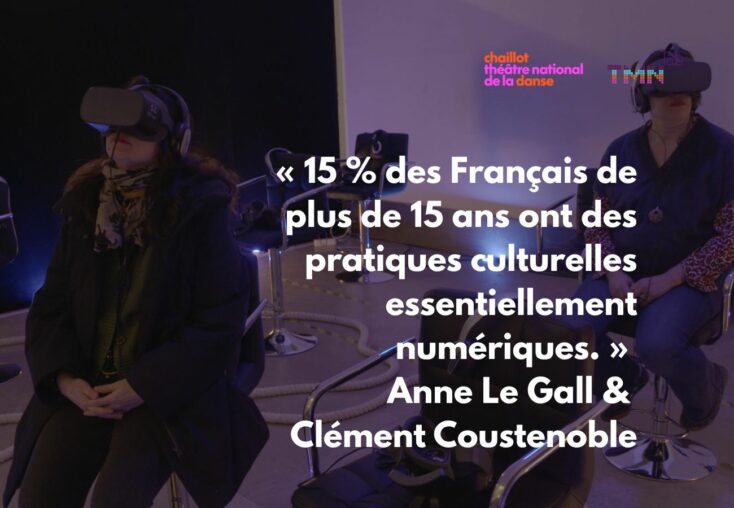A l’occasion d’une intervention en binôme en ouverture des journées Chaillot Augmenté × Rencontre TMNlab 2025, Anne Le Gall (co-fondatrice et déléguée générale du TMNlab) et Clément Coustenoble (chef de projet au TMNlab) éclairent la dimension de sociabilité des environnements numériques, interrogent les représentations du spectacle vivant véhiculées par les algorithmes, et soulignent l’importance d’une évolution de la médiation culturelle et les enjeux de formation pour les professionnels comme pour les publics.
Enregistré lors de la rencontre TMNlab co-organisée avec Chaillot – Théâtre National de la Danse, jeudi 13 février 2025
SAVE THE DATE
Les prochaines journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab Art vivant et environnements numériques auront lieu les 4 et 5 mai 2026 [inscrivez-vous pour être informé en priorité]

Le TMNlab ouvre son intervention avec Knit’s Island, un documentaire réalisé à l’intérieur d’un jeu vidéo. Ce dernier se compose d’un territoire virtuel de 250 km² dans lequel des communautés vivent une fiction survivaliste. L’exemple illustre la capacité des environnements numériques à devenir des lieux de sociabilité et des terrains d’exploration pour les artistes et les auteurs.
Anne Le Gall expose un fait majeur : 15 % des Français de plus de 15 ans ont des pratiques culturelles essentiellement numériques (source : DEPP, 2018) : jeux en ligne, streaming, plateformes, métavers… C’est une catégorie qui n’existait pas avant dans cette enquête qui est menée depuis le début des années 1970. Longtemps vues comme isolées ou à la marge, ces pratiques connectées produisent en réalité du lien et des communautés. Il est temps pour les institutions et les politiques culturelles de réviser leurs représentations de ces sociabilités nouvelles.
Clément Coustenoble pose une question simple : « parmi ces 15 %, quelle part croise ce qu’on appelle les publics éloignés des institutions ? ». Le TMNlab invite à examiner nos représentations communes de la culture : comment percevons-nous les pratiques numériques ? Et comment les algorithmes représentent-ils le spectacle vivant ? Anne Le Gall note, par exemple, que la représentation du théâtre proposée par les algorithmes est extrêmement réduite : une scène encadrée par des rideaux rouges en velours et devant la scène, des sièges rouges. L’enjeu de découvrabilité (des œuvres, des lieux, de « ce qu’est une sortie au théâtre ») devient alors stratégique pour les institutions.
Côté création, les exemples d’hybridation arts vivants et arts numériques abondent aujourd’hui : « réalités étendues, intelligence artificielle, dispositifs immersifs, autant de briques pas toujours nouvelles qui s’hybrident avec la scène, dans les murs ou hors les murs », explique Anne Le Gall, qui prévient cependant que « chaque environnement numérique doit être bien compris et étudié » — contraintes techniques, cadres juridiques et modèles diffèrent. Le numérique n’est ni un canal unique ni un horizon homogène : c’est une cartographie de milieux.
Ces mutations atteignent aussi l’univers de la médiation. Anne Le Gall souligne l’émergence de nouveaux médiateurs (créateurs de contenus, influenceurs) : « à certains endroits, ils sont en relation plus directe avec les publics que l’artiste ou l’institution ». Cette intermédiation ne remplace pas la médiation culturelle ; elle l’étend et exige de nouvelles coopérations. Par exemple, la faible structuration des données dans le spectacle vivant freine les communautés en ligne (à l’inverse du livre et de l’ISBN).
Reste un verrou majeur : l’illectronisme qui touche 17 % des Français (source : INSEE, 2019). Autre chiffre alarmant : « 60 % d’agents territoriaux ont besoin d’être formés au numérique » (source : PIX, 2020), avance Anne Le Gall. « Sans formation, on ne peut pas développer d’usages, et encore moins d’usages critiques. La formation et la médiation conditionnent la capacité à comprendre, documenter et partager ces sociabilités numériques », ajoute-t-elle.
Ainsi, les territoires numériques ne peuvent plus être ignorés des institutions culturelles concluent-ils. Ils appellent, alors, à un investissement massif sur la formation des équipes et sur la médiation auprès des publics et leur accompagnement dans les pratiques numériques.
« Et maintenant, comment définiriez-vous in real life ? », ironise Anne Le Gall.
Cet article a été rédigé avec l’appui de l’IAgen, d’après la retranscription textuelle du podcast.
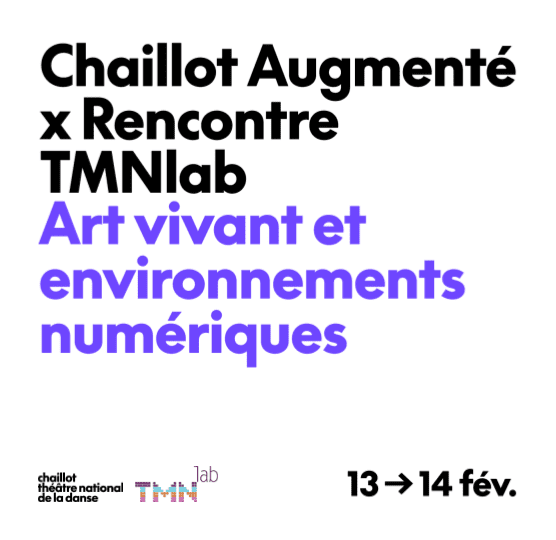
Explorez les contenus produits lors des journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab : Art vivant et environnements numériques les 13 et 14 février 2025 : tous les podcasts [écouter], toutes les tables-rondes [écouter], les présentations de l’espace démo [découvrir] !
Cet événement s’est tenu le cadre du Sommet pour l’action sur l’IA.