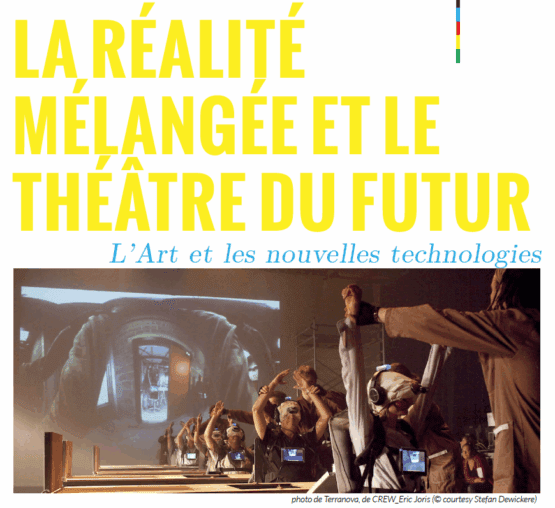Régulièrement dans nos recherches, nous voyons émergé des ressources d’une grande richesse… publiée des années auparavant. Ici, une publication de 2017 signée du chercheur Joris Weijdom pour l’IETM. Si les spécificités technologiques et les exemples précis de matériel de 2017 sont probablement obsolètes, les questions fondamentales sur la scénographie, la dramaturgie, la participation du public, et la collaboration interdisciplinaire posées par Joris Weijdom sont d’une pertinence essentielle pour quiconque conçoit des expériences de réalité mélangée en 2025. Le rapport sert ainsi de boussole conceptuelle, rappelant que l’innovation réside moins dans la puissance de la technologie que dans la manière dont elle est intégrée au service de la cohérence et de la profondeur de l’expérience artistique.
Le rapport
J. Weijdom, « La réalité mélangée et le théâtre du futur. Nouvelles Perspectives sur l’art et les nouvelles technologies », IETM, mars 2017. Lien : https://www.ietm.org/en/publications
Joris Weijdom est maître de conférences et chercheur à l’Université des Arts d’Utrecht (HKU). Il conçoit des expériences de réalité mixte axées sur les processus créatifs interdisciplinaires et la performativité. De 2012 à 2015, il a créé et dirigé le Laboratoire des médias et de la performance (MAPLAB), favorisant la recherche artistique par la pratique à l’intersection de la performance, des médias et des technologies. Dans le cadre de son doctorat, Joris étudie les processus créatifs dans les environnements collaboratifs de réalité mixte (ECRM).
L’IETM est un réseau européen dédiées aux arts du spectacle, réunissant structures et membres individuels du monde entier qui travaillent dans le secteur des arts du spectacle contemporains : le théâtre, la danse, le cirque,
les formes artistiques vivantes interdisciplinaires, les nouveaux médias. L’IETM défend la valeur des arts et de la
culture dans un monde en changement et offre aux professionnels du spectacle vivant les moyens d’accéder à des connexions internationales, à des connaissances et à un forum d’échange dynamique.
Analyse du document : Au regard des évolutions sociétales et technologiques, ce rapport de 2017 est-il encore pertinent en 2025 ? Si oui, quels sont les éléments pertinent et lesquels semblent dépassés ?
Cette partie a été rédigée avec l’aide un outil d’analyse de document IAgen (type RAG) et révisée par un humain.
En 2017, l’auteur Joris Weijdom (chercheur et concepteur d’expériences théâtrales utilisant les technologies de réalité mélangée) reconnaissait que les avancées technologiques, notamment la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA), progressaient à une vitesse incroyable. Il était même déjà étrange de qualifier ces technologies de « nouvelles ».
Les éléments qui conservent leur pertinence sont principalement conceptuels, dramaturgiques et méthodologiques, car ils s’attaquent aux questions fondamentales de l’expérience artistique, quelle que soit la génération de matériel technologique utilisée :
Le positionnement conceptuel du théâtre
- Le théâtre, intrinsèquement réalité mélangée : L’affirmation selon laquelle une pièce de théâtre traditionnelle est déjà, à bien des égards, une expérience de réalité mélangée (RM) est un point de départ philosophique qui reste pertinent. Le théâtre traite depuis des siècles du mélange entre espaces réels et virtuels, remettant en question la perception de la réalité et la compréhension de la présence.
- Recherche d’une profondeur artistique : L’objectif de la publication était d’encourager la recherche commune d’une profondeur artistique expérimentale au-delà de « l’effet waouh ». Cette nécessité de trouver un sens au-delà de la nouveauté technologique est d’autant plus cruciale que les technologies se banalisent.
La méthodologie et le processus de conception
- Itérations et Prototypes : La recommandation de mener conjointement les développements artistique et technologique dès le début du processus, en privilégiant les itérations de conception et la création de prototypes, est une méthodologie saine qui demeure valable.
- Partage des échecs : L’insistance pour que les collaborateurs partagent leurs questions et leurs échecs plutôt qu’une histoire épurée de succès constitue une approche d’apprentissage critique et toujours utile dans un domaine en évolution rapide. L’auteur espère d’ailleurs que la communauté n’arrivera jamais au point de tout « connaître » définitivement, car cela mettrait fin aux explorations passionnantes.
- Développement d’outils de performance : La suggestion de développer des outils technologiques de performance à long terme, adaptables et modulables, plutôt que des solutions techniques à court terme axées uniquement sur un projet spécifique, est une perspective stratégique qui favorise l’innovation continue.
La dramaturgie et les perspectives du Public
- La scénographie des environnements mélangés : Les questions sur la manière de construire la scénographie des environnements de réalité mélangée, où plusieurs espaces physiques et virtuels existent simultanément, restent centrales.
- L’exploration des conflits : L’idée que le spectateur est « vraiment appelé à s’impliquer » dans les incohérences et les conflits entre réalités parallèles (illustrée par Terra Nova) est une décision dramaturgique forte qui ne dépend pas de la technologie.
- Niveaux de participation : L’importance de considérer plusieurs perspectives du public et d’intégrer des niveaux de participation (incluant la « règle des 1-9-90 » issue de la culture Internet) pour permettre aux spectateurs de choisir leur degré d’interaction ou d’influence, demeure un défi majeur dans la conception d’expériences participatives.
La collaboration interdisciplinaire
- Nécessité de l’interdisciplinarité : Le constat que les projets de RM exigent l’élargissement des connaissances multidisciplinaires, intégrant des spécialistes des arts du spectacle, de l’informatique, de la conception de jeux vidéo et des médias, est fondamental.
- Développement d’une langue commune : La nécessité de dépasser la collaboration multidisciplinaire pour atteindre un procédé interdisciplinaire où une langue partagée, ou hybride, émerge afin de relier les savoir-faire et résoudre les malentendus méthodologiques est un enjeu de gestion de projet toujours d’actualité.
Les éléments qui pourraient sembler dépassés en 2025 sont principalement liés à la rapidité de l’évolution technologique et à la maturité des outils :
- Le statut de « nouvelles » technologies : En 2017, la publication notait déjà qu’il était étrange de qualifier ces technologies de « nouvelles ». En 2025, la réalité mélangée – d’ailleurs nous parlons aujourd’hui plutôt de réalité mixte – est considérée comme un médium bien établi dans l’industrie créative, moins lié à l’effet de nouveauté et plus à des outils standardisés. Même si ces technologies continuent à chercher un modèle économique et que leur usage dans le champ de la création sont loin d’être stabilisé. Pour le spectacle vivant, des projets comme C.A.L.I.P.S.O – Choreographique Art Lab for Immersive Public and Spaces à Chaillot – Théâtre National de la Danse, FabLux à la Scène National de Valence, Synergies 2.0 à la MC2 de Grenoble ou le projet de filiale de production impulsée par le Pôle Pixel et le TNP seront pour les prochaines années des espaces clés de réflexion et de création.
- La miniaturisation et l’accessibilité : Le rapport mentionne que les technologies (matériels et logiciels) deviennent de plus en plus faciles à utiliser et plus abordables. Cette tendance s’étant accélérée, notamment récemment avec l’essor de l’IA dans la création d’environnement immersif, les barrières technologiques et financières décrites en 2017 pour les groupes de théâtre traditionnels pourraient être considérablement abaissées en 2025, rendant certaines difficultés techniques exposées dans les exemples moins prégnantes. Néanmoins, la conjoncture économique du secteur pousse plutôt à une concentration des acteurs qu’à une diversité de la création. Qui plus est les compétences nécessaires (notamment les creative technologist) sont rares et les budgets de production restent à ce jour très au-delà des budgets accessibles pour les lieux. Enfin, un point majeur repose sur les jauges au regard des temps de montage avec des taux de rentabilité très défavorables. Des projets ont émergé, comme Le Bal de Paris de Bianca Li, No reality now de Vincent Dupont ou Germination de Joris Mathieu, qui ouvrent de nouvelles perspectives en terme de capacité de billetterie.
- Exemples spécifiques de technologies/projets datés : Les références à des technologies spécifiques de l’époque (comme la mention de la technologie Magic Leap « à venir » ou les exemples de projets développés entre 2011 et 2016 tels que Terra Nova, blackmarket, et To be with Hamlet) sont historiquement précieuses pour illustrer les concepts, mais les capacités techniques précises de ces systèmes de 2017 sont surpassées en 2025 par de nouveaux standards de RV et de RA.