L’essor des technologies numériques a profondément transformé les métiers du spectacle vivant, des processus de planification à la gestion des publics, en passant par la billetterie et la communication. Éditeurs de solution, institutions du spectacle vivant et pouvoirs publics partagent de nombreux questionnements – points de départ de nos travaux – avec différents angles. La nécessité d’un dialogue constant est avérée mais se heurte à une réalité de terrain : enjeux hétérogènes, budgets limités, gouvernance impensée.
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement à la transformation numérique des lieux de spectacle vivant, la Communauté TMNlab mène des études ayant pour objectif d’aider les structures à améliorer leurs usages du numérique. Nous publions aujourd’hui le fruit de ce travail : l’étude Interopérabilité des systèmes d’information dans le spectacle vivant (2025) dirigée par le TMNlab, menée par Judith Afokpa – PMT Consultants, avec le soutien du ministère de la Culture (Service du Numérique) et des sept éditeurs : GHS, Heeds, Mapado, Supersoniks, IT4Culture, Ressources SI et Movinmotion.
Introduction du rapport
L’étude menée cette année met en lumière une réalité partagée par la quasi-totalité des structures du spectacle vivant : leurs systèmes d’informations sont riches, mais fragmentés.
Chaque activité – programmation artistique, billetterie, contrats, plannings, paie, comptabilité, ressources humaines, reporting – dispose d’outils dédiés, parfois performants dans leur périmètre, mais rarement reliés entre eux. Le résultat est une organisation où la double saisie est omniprésente, où la circulation de l’information dépend encore trop de relais humains, et où le potentiel stratégique des données reste largement sous-exploité.
Au cœur de ce constat se trouve la programmation artistique, véritable donnée pivot de l’écosystème, encore ressaisie dans de multiples applications. Autour d’elle, d’autres chantiers apparaissent tout aussi cruciaux : fluidifier le lien entre plannings et paie, billetterie et comptabilité, ou encore renforcer la gouvernance des bases de contacts et la conformité au RGPD. Le reporting illustre particulièrement les limites actuelles : des heures sont consacrées à la compilation de tableaux plutôt qu’à l’utilisation des données pour aider au pilotage, alors même que les tutelles multiplient les demandes de données.
Ces constats ne traduisent pas seulement une recherche d’efficacité administrative. Ils ouvrent des perspectives beaucoup plus larges : l’interopérabilité est désormais perçue comme un levier pour répondre à des enjeux de société. Plusieurs structures interrogées évoquent la nécessité de mieux partager les informations relatives à l’accessibilité, de mutualiser les indicateurs pour la transition écologique et la RSE, ou encore de renforcer la coopération artistique et culturelle par des référentiels partagés. Autrement dit, la question technique se double d’une réflexion politique sur la manière dont les données peuvent transformer le secteur.
Les éditeurs de solutions interrogés confirment ce mouvement. La plupart déclarent avoir inscrit l’interopérabilité dans leur feuille de route, avec des API disponibles et des connecteurs déjà opérationnels. Mais les obstacles persistent : documentation inégale, rapports de force entre « gros » et « petits » éditeurs, absence de standards communs, coûts de développement laissés à la charge des clients. Tous s’accordent néanmoins sur un point : les données appartiennent aux structures, et non aux logiciels. La mise en place de référentiels partagés et d’un data space sectoriel émerge ainsi comme une piste centrale, à condition d’être portée par une gouvernance neutre, indépendante des intérêts privés.
L’interopérabilité n’est plus une question secondaire ou purement technique : elle est au cœur de la transformation du spectacle vivant. Elle impacte la capacité des structures à piloter leurs activités, à répondre aux obligations administratives et structurelles croissantes, mais aussi à inventer de nouvelles manières de coopérer, d’accueillir les publics et de répondre aux urgences sociales et écologiques. Et au-delà, elle rappelle que le numérique doit être davantage au cœur des enjeux des structures, tant sur le plan du pilotage et de la gouvernance que dans les pratiques de travail quotidiennes.
Les structures, les éditeurs et les pouvoirs publics en sont désormais convaincus : il faut avancer collectivement, définir des standards, mutualiser les efforts, et construire une gouvernance partagée. L’interopérabilité apparaît ainsi comme un levier de transformation durable et d’innovation partagée pour tout le secteur.
Contenu et recommandations
Le rapport s’articule en 3 parties principales :
- les résultats et synthèses intermédiaires des réponses des acteurs du spectacle vivant, incluant une cartographie-type des flux de données
- les résultats et synthèses des réponses des éditeurs de solutions sectorielles
- la synthèse globale et les recommandations en terme de chantiers à mener
Il donnera lieu à divers groupes de travail.
Si vous souhaitez contribuer ? Écrivez-nous.
Consultez le rapport en ligne :

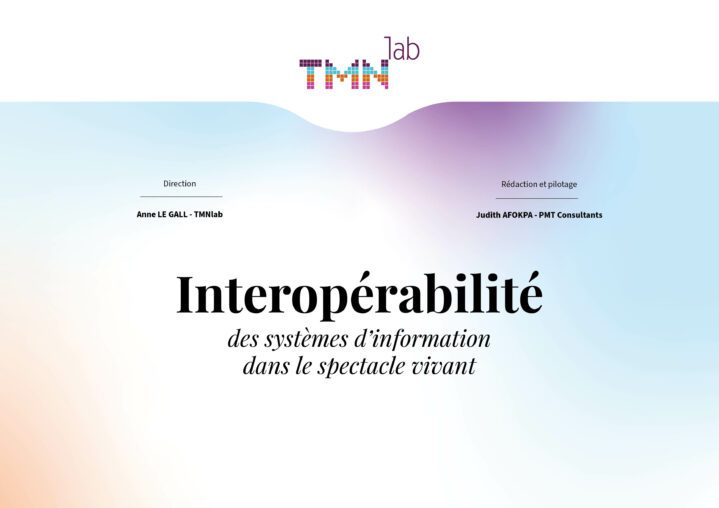
Les caractères du volumineux document PDF ne sont pas reconnus et cela rend les annotations difficiles. Il serait bien de le traiter via OCR et de le partager sous une nouvelle version.
Tu as un outil en tête pour faire cela ? On a du travailler dans un environnement numérique moins adapté et le PDF est un peu bricolé, je le reconnaîs