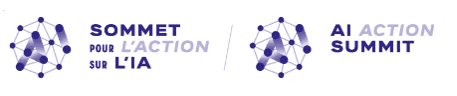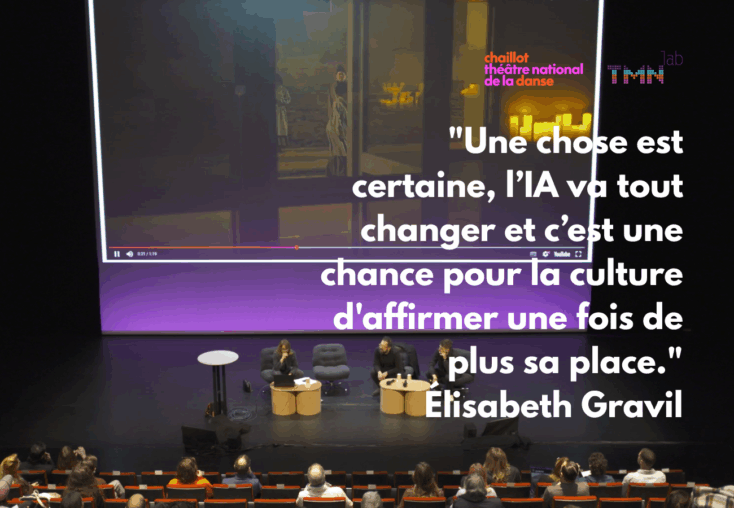Lors des journées Chaillot Augmenté × Rencontre TMNlab 2025, Élisabeth Gravil, consultante en ingénierie culturelle et IA, et fondatrice de Museovation, a proposé une mise en perspective de l’IA.
De l’onde de choc AlphaGo en 2016 à l’IA générative d’aujourd’hui, l’IA devient un enjeu culturel autant qu’économique et politique. Elle appelle les institutions à conjuguer discernement, expérimentation et coopérations (artistes, publics, recherche), afin d’éviter une nouvelle fracture et d’ouvrir des communs de l’IA.
Enregistré lors de la rencontre TMNlab co-organisée avec Chaillot – Théâtre National de la Danse, jeudi 13 février 2025
SAVE THE DATE
Les prochaines journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab Art vivant et environnements numériques auront lieu les 5 et 6 mai 2026 [inscrivez-vous pour être informé en priorité]

Élisabeth Gravil pose d’emblée le cadre : « L’intelligence artificielle était un enjeu économique, on a prouvé récemment que c’était un fort enjeu politique. Mais plus que tout, elle va devenir un enjeu culturel. Comment nous, institutions, allons-nous l’embrasser — dans nos organisations, auprès des artistes, auprès des publics ? ».
Élisabeth Gravil revient sur la défaite en 2016 de Lee Sedol, considéré comme le meilleur joueur du monde à l’époque, face à AlphaGo, l’ordinateur surpuissant de Google. Le 36ᵉ coup d’AlphaGo sidère le champion et stimule toute la communauté du Go. L’important pour lui n’est pas d’avoir perdu mais qu’Alphago ait joué un coup contraire à toutes les règles du jeu de Go que les grands maîtres pratiquent depuis des millénaires. L’algorithme de Google a donc ouvert de nouvelles perspectives aux joueurs de Go. « L’intelligence artificielle, en fait, est le miroir de nous-mêmes », analyse Élisabeth Gravil.
Depuis 2022, avec le déploiement massif de l’IA générative, la tension s’accentue entre un ordonnancement algorithmique du monde et une humanité faite de fragilités et d’ambivalences : « Nous sommes faits de chair et d’os, d’émotions, de chaos. » Entre fascination et sentiment de déclassement, « l’IA générative s’empare du dernier bastion qui nous définit, celui de la créativité », explique-t-elle. Les philosophes appellent cela notre « quatrième blessure narcissique », d’autres parlent plutôt de « quatrième décentrement ».
Face à ce questionnement existentiel, « une chose est certaine, l’IA va tout changer, mais nous ne savons pas par quel bout prendre cette équation qui a tant d’inconnues », constate Élisabeth Gravil qui voit dans cette incertitude, une chance pour la culture d’affirmer une fois de plus sa place, parce que la culture questionne et ouvre le champ des possibles : « Quelles réflexions pouvons nous nous proposer à nos publics, à nos artistes ? Comment investir ces territoires inconnus ? ».
Pour saisir cette chance, la culture doit rester fidèle à ses missions culturelles, sans immobilisme. « Nous devons faire entendre un discours critique — au sens du discernement — et envisager des innovations de rupture. » Condition sine qua non : reprendre la main sur nos données, nos outils, nos cadres. « Il va falloir accompagner les artistes dans l’usage et la compréhension de l’IA, défendre leurs droits, et aider nos publics à naviguer dans des eaux encore troubles. »
Cap stratégique : faire de l’IA une ressource commune. Éviter l’élitisme qui créerait une nouvelle fracture numérique et travailler l’IA comme un commun : accès aux données d’entraînement variées, diversité d’algorithmes (transparence, empreinte carbone), accès aux infrastructures (GPU). Les musées ouvrent des voies ; le spectacle vivant doit s’y engager pour peser dans les choix techniques et politiques.
Trois enjeux structurants :
- Compréhension/formation : urgence à comprendre, pas à se précipiter ; combattre fantasmes et rejets.
- Exploration : multiplier les bacs à sable et incubations pour tester usages et cadres.
- Communs créatifs : co-construire des outils accessibles, collectifs, porteurs de sens.
La politique culturelle de l’IA passe par la médiation, par des alliances avec chercheurs, ingénieurs, philosophes, et par la consolidation de valeurs démocratiques et environnementales. Avec une finalité : élargir les imaginaires du présent, avec et contre la machine.
Cet article a été rédigé avec l’appui de l’IAgen, d’après la retranscription textuelle du podcast.
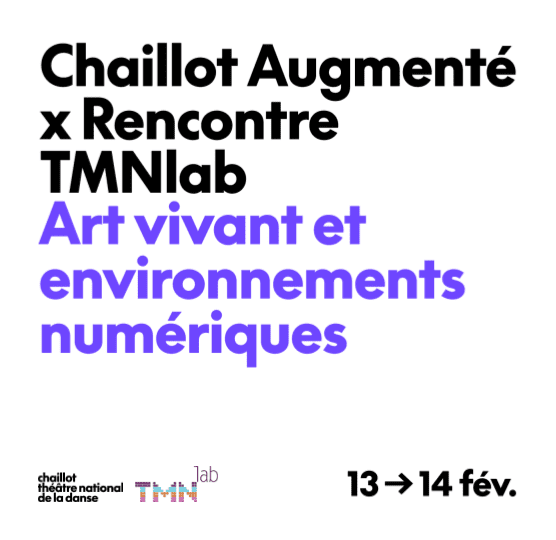
Explorez les contenus produits lors des journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab : Art vivant et environnements numériques les 13 et 14 février 2025 : tous les podcasts [écouter], toutes les tables-rondes [écouter], les présentations de l’espace démo [découvrir] !
Cet événement s’est tenu le cadre du Sommet pour l’action sur l’IA.