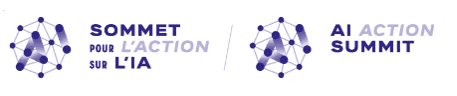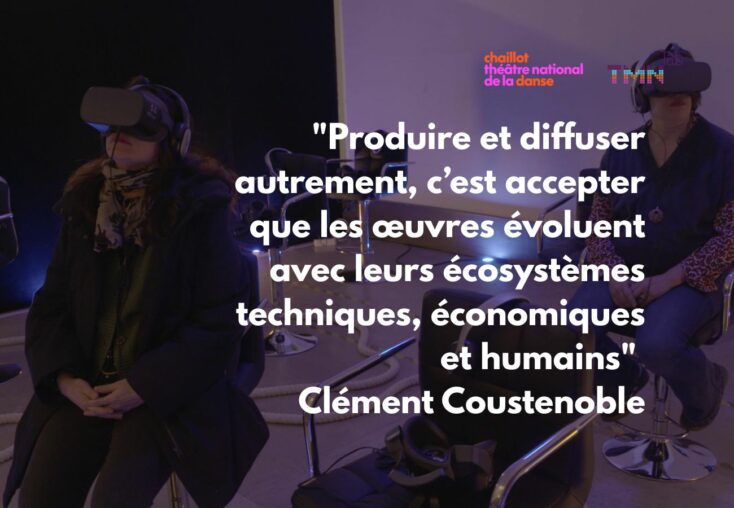Comment inventer des modèles de production et de diffusion adaptés aux créations numériques, entre innovations technologiques, nouveaux usages et contraintes économiques ? A l’occasion des journées professionnelles Chaillot Augmenté x Rencontres TMNlab en février 2025, retour sur la table-ronde Production et diffusion des créations en environnement numérique, quelles perspectives ?
Clément Coustenoble, chef de projet du TMNlab, a animé une discussion avec Alexandre Roux (Lucid Realities / Unframed Collection), Frédéric Lecompte (Backlight), Marie Point (Dark Euphoria) et Line Abramatic (Gengiskhan, Mesden Valley). Ensemble, ils et elles ont esquissé les contours d’un écosystème en mutation, où la logique de projet cède la place à celle du réseau, et où la durabilité devient une condition de la création comme de la diffusion.
Enregistré lors de la rencontre TMNlab co-organisée avec Chaillot – Théâtre National de la Danse, vendredi 14 février 2025
SAVE THE DATE
Les prochaines journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab Art vivant et environnements numériques auront lieu les 5 et 6 mai 2026 [inscrivez-vous pour être informé en priorité]

Produire dans la durée
La production d’œuvres immersives suppose de sortir d’une logique de prototype pour penser des œuvres vivantes, capables d’évoluer avec leurs contextes techniques et leurs publics. Alexandre Roux, directeur de la stratégie et du développement chez Lucid Realities et cofondateur de la plateforme Unframed Collection, plaide pour le passage à une économie de répertoire :
« Nous devons inventer des cycles de vie longs, où les œuvres continuent d’exister, de se transformer et de circuler. » — Alexandre Roux
Ce passage d’une économie de la nouveauté à une économie de la maintenance et de la réactivation rejoint la vision de Marie Point, directrice de Dark Euphoria, pour qui produire une œuvre, c’est aussi produire les conditions de sa transmission. Cette durabilité concerne autant les outils que les liens humains : maintenir un collectif, documenter les méthodes, partager les savoirs. C’est à cette condition que la recherche et la création peuvent s’entrelacer et former des communautés d’apprentissage, plutôt qu’une simple chaîne de production.
Collaborer autrement
L’interdépendance des métiers du numérique bouleverse les hiérarchies traditionnelles. Frédéric Lecompte, cofondateur de Backlight, décrit un processus créatif fondé sur la collaboration entre artistes, ingénieurs, développeurs et techniciens :
« Dans notre équipe, il n’y a pas d’un côté les artistes et de l’autre les ingénieurs. On conçoit ensemble dès le départ, et souvent ce sont les développeurs qui apportent les idées décisives pour la narration ou pour l’interaction. » — Frédéric Lecompte
Cette approche collective transforme la production en un laboratoire de co-écriture, où la technique devient un langage partagé. Marie Point souligne que ces formats de travail collaboratifs exigent du temps, de la médiation et de la confiance :
« On ne produit pas une expérience immersive en quelques semaines, il faut des espaces pour tester, échouer et recommencer. » — Marie Point
Pour Line Abramatic, fondatrice de Gengiskhan et présidente de Mesden Valley, le modèle traditionnel de la salle de spectacle ne suffit plus à accueillir ces nouvelles écritures. Il est donc nécessaire de repenser la place du public et de mettre en place les conditions de sa collaboration, devenue centrale dans la réussite de l’œuvre :
« Les créations numériques et immersives déplacent les repères de la diffusion : elles ne se mesurent pas à la jauge, mais à la qualité de l’expérience et du niveau de participation qu’elles suscitent. » — Line Abramatic
Vers une diffusion partagée et responsable
« On ne programme pas une œuvre immersive, on l’accueille. » — Line Abramatic
Pour les quatre intervenants, les créations numériques et immersives circulent dans une logique de réseau fondée sur la coopération. Alexandre Roux évoque « une communauté d’acteurs où chacun apporte une ressource — un lieu, une compétence, une technologie ». Marie Point décrit cette dynamique comme un processus continu :
« Une œuvre n’est pas simplement présentée, elle est activée, adaptée, traduite selon le contexte et les publics. » — Marie Point
Les œuvres deviennent ainsi des dispositifs ouverts, qui se réécrivent au contact de ceux qui les diffusent. Frédéric Lecompte rappelle que cette logique suppose de mutualiser infrastructures et savoir-faire : serveurs, casques, maintenance, médiation. Ce passage d’une économie de la programmation à une économie du réseau marque une véritable mutation culturelle : celle d’une diffusion participative, distribuée et durable. Penser la durabilité, c’est intégrer dès la conception la maintenance, la mise à jour, le stockage et la réversibilité des dispositifs.
Un écosystème à construire
L’enjeu n’est plus de créer un modèle unique, mais de relier les initiatives existantes dans un écosystème ouvert, fondé sur la coopération, la documentation et la responsabilité. Un paysage où la production se pense dans la durée, la diffusion dans la relation, et l’innovation comme une attention partagée au vivant — qu’il soit humain, technique ou artistique.
Session de questions avec le public
Reconnaissance, statut et financement
Les questions du public ont d’abord porté sur la reconnaissance institutionnelle des pratiques immersives : comment financer, produire et valoriser des œuvres qui échappent aux cadres traditionnels du spectacle vivant ou de l’audiovisuel ? Les intervenants ont souligné la nécessité d’une évolution des politiques publiques pour accompagner ces formats. Alexandre Roux a insisté sur la complexité d’un modèle économique encore instable :
« Le plus grand défi, c’est de faire comprendre que ces œuvres relèvent à la fois de la culture, de la recherche et de l’innovation. » — Alexandre Roux
Conditions de travail et partage des risques
Le public a également soulevé la question des conditions de production. Marie Point a rappelé que les créations numériques reposent sur des équipes hybrides et souvent précaires, confrontées à des exigences techniques lourdes :
« Il faut inventer des cadres de travail qui garantissent la sécurité et la juste rétribution de tous les contributeurs. » — Marie Point
Cette discussion a ouvert un débat sur la mutualisation des ressources : studios, serveurs, outils de gestion de projet. Pour Frédéric Lecompte, ces coopérations doivent s’inscrire dans des logiques de filière et non de projet isolé.
Cet article a été rédigé avec l’appui de l’IAgen, d’après la retranscription textuelle du podcast.
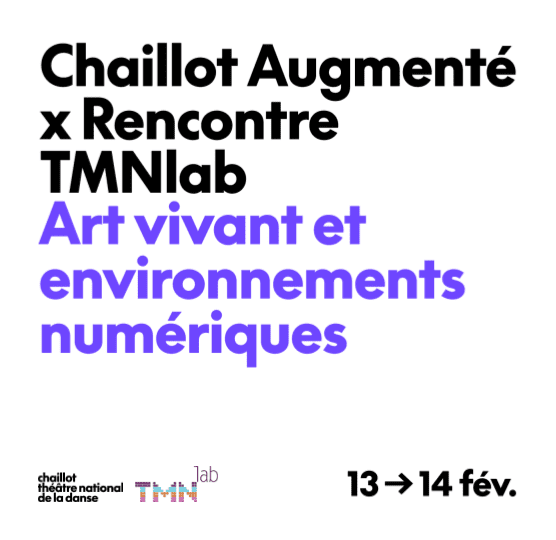
Explorez les contenus produits lors des journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab : Art vivant et environnements numériques les 13 et 14 février 2025 : tous les podcasts [écouter], toutes les tables-rondes [écouter], les présentations de l’espace démo [découvrir] !
Cet événement s’est tenu le cadre du Sommet pour l’action sur l’IA.