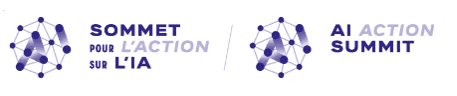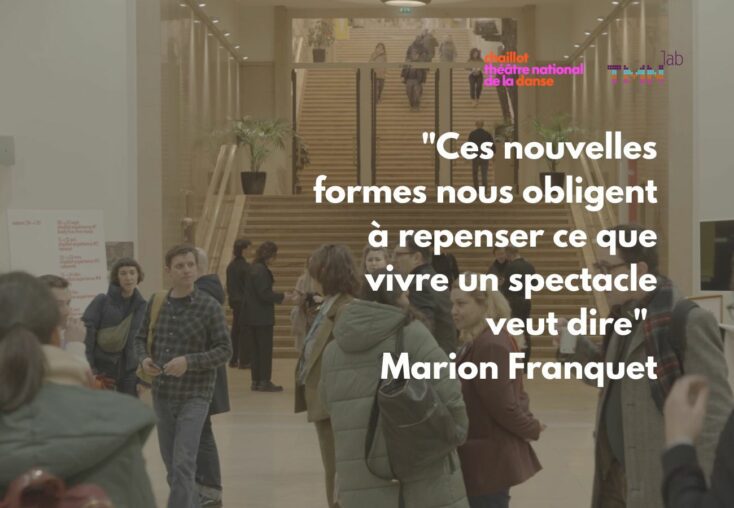Dans le cadre de Chaillot Augmenté × Rencontre TMNlab 2025, Marion Franquet, secrétaire générale de la Scène Nationale Carré-Colonne et présidente du TMNlab, animait une table-ronde Comment les publics vivent ces formes en environnement numérique ?
Avec Marie Ballarini, enseignante chercheure à l’université Paris Dauphine-PSL, co-autrice d’une « Analyse de l’Impact des Technologies de Réalité Virtuelle et Augmentée dans le Spectacle Vivant« , Cyrielle Garson, maîtresse de Conférences à Avignon Université, spécialiste du théâtre américain et canadien dans le « métavers », et Izabella Pluta, chercheuse associée au Centre d’Etudes Théâtrales (CET) de Lausanne, fondatrice et responsable du Theatre in Progress, co-autrice de « Quels rôles pour le spectateur à l’ère numérique ? »
Ensemble, elles ont exploré la manière dont les environnements numériques transforment l’expérience du public — sa présence, sa participation, son attention — et redéfinissent la place du spectateur dans l’écosystème de la création.
Enregistré lors de la rencontre TMNlab co-organisée avec Chaillot – Théâtre National de la Danse, vendredi 14 février 2025
SAVE THE DATE
Les prochaines journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab Art vivant et environnements numériques auront lieu les 5 et 6 mai 2026 [inscrivez-vous pour être informé en priorité]

Un bouleversement en profondeur des codes du spectacle vivant
Marie Ballarini observe que les formes immersives et hybrides « brouillent la hiérarchie entre le plateau et la salle » : l’expérience ne se déroule plus devant le spectateur, mais avec lui. Dans le métavers ou les dispositifs interactifs qu’étudie Cyrielle Garson, il n’y a plus de scène unique : plusieurs espaces, réels et virtuels, se superposent et se répondent. L’expérience repose sur une cohabitation d’espaces et de présences.
« Le spectateur n’assiste pas à une représentation, il y participe. Il agit, déplace la caméra, choisit son angle de vue, parfois même il intervient dans la scène. » — Cyrielle Garson
Le spectateur devient un participant actif, parfois co-auteur de l’œuvre ; son rôle se déplace sans cesse entre observation et action. Marie Ballarini observe, en outre, que la réalité virtuelle et augmentée font émerger de nouvelles formes de présence. Le spectateur ne se situe plus seulement dans la salle : il devient une entité distribuée, connectée, dont les données et les gestes prolongent l’expérience dans l’espace numérique.
Repenser l’accueil du spectateur
Cette mutation des conventions impose de nouveaux modes d’accompagnement. Marie Ballarini souligne que ces expériences nécessitent d’inventer un cadre d’hospitalité, car les spectateurs n’ont plus de repères établis. L’immersion provoque autant de curiosité que de désarroi ; elle engage le corps et les émotions, mais elle peut aussi désorienter le spectateur et nuire à la compréhension du récit.
« Il ne suffit pas d’inviter un public dans un dispositif numérique : il faut penser les seuils, les consignes, l’accompagnement émotionnel. » — Marie Ballarini
Cyrielle Garson souligne aussi les enjeux d’attention — distractions, multi-fenêtrage — et d’éthique — respect, modération, consentement. Les œuvres efficaces, selon elle, formulent un protocole clair : seuil d’entrée, règles minimales, objectifs d’expérience. Dans le métavers, on négocie ainsi sa place dans un espace commun.
Le spectateur augmenté comme sujet critique
Izabella Pluta, chercheuse associée au Centre d’Études Théâtrales de Lausanne, voit dans ces dispositifs numériques une invitation à repenser le rôle du spectateur. Être « augmenté », dit-elle, c’est aussi mesurer les limites de son attention, de sa liberté et de son consentement.
« Le spectateur augmenté n’est pas passif : il expérimente les zones d’influence entre le corps, la machine et le regard. » — Izabella Pluta
Les expériences immersives posent de nouvelles questions éthiques : que deviennent les traces du spectateur, son image, ses données ? Ces créations nous rappellent que chaque geste, chaque regard, chaque mouvement du corps est désormais intégré dans un système d’interactions où l’intime rencontre la technologie.
Une culture de la médiation à inventer
Les intervenantes s’accordent sur un point essentiel : l’enjeu n’est pas tant de séduire les publics par la technologie que de les accompagner dans la découverte de ces formes. Le numérique déplace les cadres d’expérience, mais il peut aussi renforcer le lien entre l’œuvre et le spectateur s’il est pensé comme un espace d’échange et d’écoute. En effet, le numérique ne remplace pas la rencontre, il la déplace. Il nous oblige à repenser ce que “être ensemble” veut dire dans des dispositifs où chacun vit une expérience différente, mais partage un même espace de perception.
Session de questions avec le public
Postures de spectateur : curiosité, désorientation
Les interventions du public ont pointé la difficulté à « se situer » dans les dispositifs immersifs : on oscille entre excitation et perte de repères, selon qu’on est équipé, observateur ou hors dispositif. Les intervenantes ont rappelé qu’il faut penser ces formes comme des espaces de relation plutôt que comme des démonstrations techniques.
« La technologie ne suffit pas à créer une présence : c’est l’attention partagée qui fonde l’expérience. » — Marie Ballarini
Accompagnement et hospitalité
La discussion a convergé vers l’importance d’un cadre d’hospitalité : seuils d’entrée clairs, consignes simples, repères pendant l’expérience, et temps d’“après-coup” pour mettre en mots ce qui a été vécu.
« On entre dans une fiction sans scène, mais avec des règles d’hospitalité. » — Cyrielle Garson
Une éducation aux formes immersives est souhaitée, pour que chacun sache comment participer sans se sentir perdu ou exclu.
Éthique, traces et consentement
Le public a interrogé la collecte potentielle d’images, de gestes ou de données biométriques. Les intervenantes ont souligné la nécessité d’une transparence sur ce qui est enregistré, pourquoi, combien de temps, et comment retirer son consentement.
« Poser un cadre clair sur ce qui est enregistré, conservé ou effacé » — Izabella Pluta
Vers de nouvelles manières d’être publics
En clôture, un consensus : ces expériences réussissent quand elles articulent intensité sensible et lisibilité du protocole. L’enjeu n’est pas de “technifier” la salle, mais d’inventer de nouvelles manières d’être ensemble — attentives, explicites et accueillantes — dans des environnements où le spectateur devient véritable partenaire d’expérience.
Cet article a été rédigé avec l’appui de l’IAgen, d’après la retranscription textuelle du podcast.
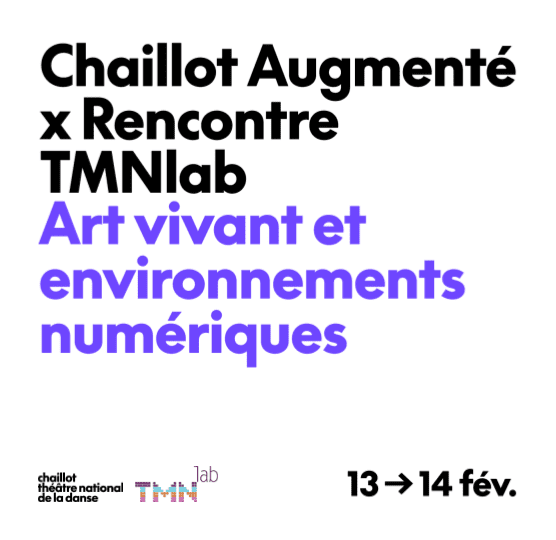
Explorez les contenus produits lors des journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab : Art vivant et environnements numériques les 13 et 14 février 2025 : tous les podcasts [écouter], toutes les tables-rondes [écouter], les présentations de l’espace démo [découvrir] !
Cet événement s’est tenu le cadre du Sommet pour l’action sur l’IA.