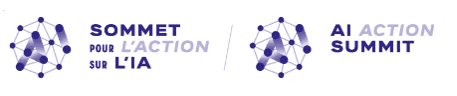Lors des journées professionnelles Chaillot Augmenté × Rencontre TMNlab 2025, Mélinda Muset Cissé, directrice de la production, des tournées et de la coordination, Chaillot – Théâtre national de la Danse, animait une table-ronde Quels nouveaux modèles de travail ?
Comment les technologies immersives, interactives et augmentées transforment-elles les temporalités, les méthodes et les logiques de production dans le spectacle vivant ? Entre artisanat, recherche et innovation, les intervenants ont esquissé les contours d’un nouvel écosystème de création.
Dialogue entre et Julien Dubuc, metteur en scène, cofondateur du collectif INVIVO, aux croisements du théâtre, des arts numériques et de la réalité virtuelle, Nicolas Rosette, coordinateur du projet Chimère (2018-2023) et Scènes augmentées (2024).
Enregistré lors de la rencontre TMNlab co-organisée avec Chaillot – Théâtre National de la Danse, vendredi 14 février 2025
SAVE THE DATE
Les prochaines journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab Art vivant et environnements numériques auront lieu les 5 et 6 mai 2026 [inscrivez-vous pour être informé en priorité]

Réinvestir le temps long
La création immersive s’inscrit dans une temporalité inédite : deux années en moyenne entre l’idée et la première, selon Julien Dubuc.
« Entre l’idée et la première du spectacle, il y a en général deux ans. » — Julien Dubuc
Ces projets exigent des phases de recherche et de tests sans finalité immédiate : des laboratoires où l’on explore et où l’on accepte l’erreur comme partie du processus. La technologie devient un outil dramaturgique, non un simple support.
Reconnaître la recherche artistique
Pour Nicolas Rosette, la clé réside dans la reconnaissance de ces temps d’expérimentation.
« Il faut revendiquer le besoin de réinvestir le temps long de la recherche. » — Nicolas Rosette
Le programme Chimères qu’il a coordonné offrait aux artistes la possibilité d’explorer sans obligation de production. Tester des dispositifs avec des publics volontaires, mutualiser les apprentissages, capitaliser les essais : cette logique de recherche et développement artistique préfigure de nouveaux modèles de collaboration.
L’artisanat comme moteur d’innovation
Les deux intervenants défendent une même posture : celle de l’artisan qui détourne, adapte et invente.
« On travaille avec ce qu’on a sous la main, on détourne beaucoup les outils. » — Julien Dubuc
Cette approche, pour Nicolas Rosette, prolonge une tradition du spectacle vivant :
« L’approche artisanale, c’est celle de notre métier depuis toujours. Les technologies du moment viennent simplement élargir nos moyens d’expression. »
Loin d’une logique industrielle, le numérique se fait terrain de jeu et de dialogue entre artistes, techniciens, producteurs et publics.
Vers un nouvel écosystème collectif
À travers ces démarches, une conviction s’impose : l’innovation technologique n’a de sens que si elle s’accompagne d’une réinvention collective des modes de travail.
La création immersive devient ainsi un laboratoire partagé, où se redéfinissent les métiers, les relations et les temporalités du spectacle vivant.
Session de questions avec le public – « Quels nouveaux modèles de travail ? »
Du pacte de confiance à la responsabilité partagée
Les échanges avec le public ont déplacé le débat vers une question essentielle : comment maintenir une relation éthique avec les spectateurs dans les dispositifs immersifs ?
Julien Dubuc a insisté sur l’importance de l’accompagnement, dès le seuil du théâtre :
« L’œuvre commence dès qu’on passe la porte. Il y a un pacte de confiance à établir : on va vous mettre un écran à deux centimètres des yeux, un casque audio, mais ça va bien se passer. »
Cette idée de pacte est devenue le fil conducteur de la discussion : la confiance, la transparence et le soin portés au spectateur font partie intégrante de la dramaturgie.
Nicolas Rosette y voit une transformation des conventions sociales :
« Ces œuvres déplacent la figure du spectateur. On entre ensemble dans un cercle magique, un pacte collectif qui redéfinit la représentation. »
Le collectif comme modèle de travail
Les échanges ont aussi mis en lumière la nécessité de décloisonner les métiers.
Nicolas Rosette a plaidé pour une implication plus large des équipes techniques, de production et de médiation dans les phases de recherche :
« Il faut arrêter de voir le numérique comme une boîte noire. Les techniciens, les médiateurs, les producteurs ont toute leur place dans la conception. »
Pour Julien Dubuc, cette approche rejoint la logique artisanale qu’il revendique : travailler avec ce qu’on a, détourner, apprendre en faisant. Ces démarches encouragent une intelligence collective où chaque partenaire, artiste ou technicien, devient contributeur à la création.
Une mutation du rapport au temps et à la production
Enfin, plusieurs participants ont interrogé les implications économiques et temporelles de ces nouvelles pratiques.
Les intervenants ont rappelé que l’expérimentation nécessite du temps, de la flexibilité et une tolérance accrue à l’échec.
Mélinda Muset Cissé a conclu :
« Ce moment charnière ouvre des perspectives inédites pour les artistes comme pour les lieux, et nous oblige à repenser nos modèles. »
Le public et les intervenants se sont rejoints sur une même conviction : ces innovations ne sont pas qu’une question de technologies, mais de culture du travail. Elles appellent à inventer des organisations plus collaboratives, où la création devient un processus partagé entre les arts, les techniques et les publics.
Cet article a été rédigé avec l’appui de l’IAgen, d’après la retranscription textuelle du podcast.
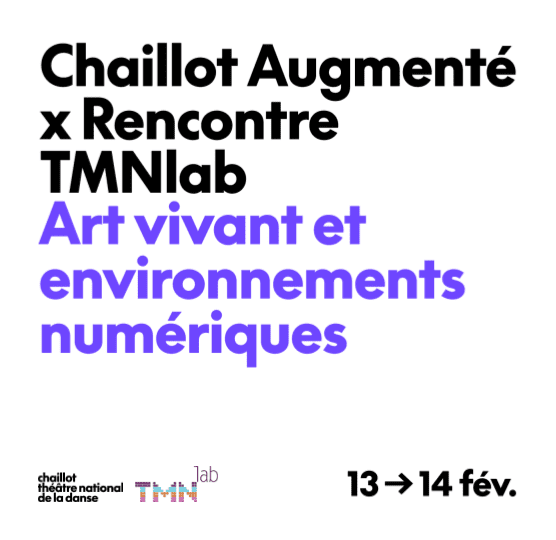
Explorez les contenus produits lors des journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab : Art vivant et environnements numériques les 13 et 14 février 2025 : tous les podcasts [écouter], toutes les tables-rondes [écouter], les présentations de l’espace démo [découvrir] !
Cet événement s’est tenu le cadre du Sommet pour l’action sur l’IA.