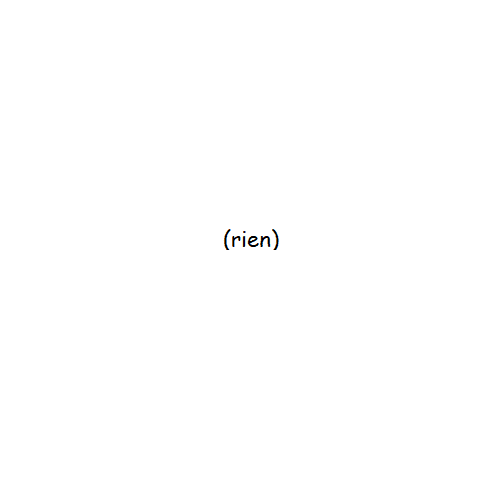A la lecture d’une publication d’Olivier Alexandre, chercheur au CNRS – Centre Internet & Société que nous recevions lors d’une rencontre en mars 2024, je suis frappée par cette question radicale : a-t-on détruit Internet et le World Wide Web ? Revue de ressources pour nourrir une réflexion commune sur le rôle des institutions de la culture dans cette époque.
Ce mercredi matin, Olivier Alexandre écrit sur Linkedin :
Sans confiance, nous serions fous d’ouvrir nos écrans (pourrait-on dire en paraphrasant le sociologue Niklas Luhmann). Or, cette confiance semble irréversiblement s’éroder sous le poids des hallucinations, deepfake, fake news, théories du complots, cyberharcèlements, cyberattaques… qui font désormais le quotidien d’Internet. Selon le baromètre d’ACSEL, 48 % des répondants déclarent ne pas avoir confiance dans Internet. Garantir une information de qualité se trouvait pourtant au cœur de la promesse de progrès et d’émancipation du réseau des réseaux. Internet est-il et peut-il (encore) être un réseau de confiance ?
La question de la confiance des usagers dans Internet n’est pas nouvelle. Les débats sur la fiabilité des informations en ligne, de la critique de Wikipédia, encyclopédie libre non exempte de défaut mais à laquelle contribuent des figures d’autorité du monde entier et des communautés garantissant autant que possible la qualité et la neutralité des contenus, à celle des forums de discussion médicaux – pour citer un cliché du genre – sont historiques. La littératie (aptitude à lire, à comprendre et à utiliser) numérique a toujours été un enjeu d’éducation – de la capacité à formuler une recherche à celle d’analyser une source – malheureusement trop peu investi par les politiques publiques. Le secteur culturel, des Espace Culture Multimédias des années 1990 aux CCSTI, lieux art-sciences ou art numérique aujourd’hui, a toujours joué un rôle.
Mais, désormais, le problème est plus profond.
Le rapport Facing reality? Law enforcement and the challenge of deepfakes (janvier 2024) produit par le Europol Innovation Lab, nous explique que la croissance des contenus synthétiques vidéo sur les plateformes de streaming est si rapide que leur volume double tous les 6 mois – et ce dès 2020. De leur côté, les plateformes d’écoute de musique font également face à un afflux sans précédent de nouveaux titres. Selon les chiffres récents de Deezer, 28 % de la musique livrée sur la plateforme de streaming est désormais entièrement générée par l’IA (source : Euronews). Évidemment, je ne parle pas de la partie des créations assistées par l’IA générative, véritables créations initiées par des êtres humains, la distinction est parfois difficile à faire. Mais l’automatisation de création de contenus rendue possible à un niveau industriel, sans même une révision humaine pour en attester la qualité, emmerdifie les plateformes.
Et l’écrit n’y échappe pas. Des « experts » le prédisent : « 90% du contenus sur Internet pourraient être synthétique« . La citation, copiée et collée un peu partout sur le web, n’est pas sourcée – ou bien j’ai mal cherché. Mais le sujet fait l’objet de nombreuses discussions, tant dans le champ des humanités numériques que des sciences du langage et ou des computer sciences. Les modèles de langage se sont entraînés sur le web, interrogent désormais le web en direct pour nous répondre : mais à quelles données auront-ils accès à l’ère des IA slop et de l’Internet Zombie ? Je ne parle pas de Walking Dead mais je fais référence à la Théorie de l’Internet Mort, flirtant avec le complotisme… mais pas si infondée, nous dit le sociologue Gérald Bronner.
Le sujet de l’authenticité et de l’autorité, au sens de sa fiabilité apparente, de sa capacité à faire autorité sur son sujet, devient un enjeu majeur pour les producteurs de connaissances et d’informations. Mais également, et toujours, la littératie numérique. Incluant notre capacité à nous poser la question de la façon dont nous accédons à cette connaissance, des choix que nous opérons dans nos recherches.
Nous sommes passés de l’utopie du web de Tim Berners-Lee en 1989, un idéal d’horizontalité, de gratuité, de liberté, à la fin de la neutralité des réseaux entérinée aux USA en janvier 2025. Et de la connaissance infinie, du délice de la sérendipité… aux réponses toutes faites. En effet, les moteurs de recherche deviennent moteurs de réponse. Quel avenir pour les producteur d’informations quand ces « portails quasi obligatoires » ralentissent l’accès aux sources ? Cela prive de prime abord l’internaute de la variété des résultats, mais également les sites web sources de leur fréquentation donc de leur notoriété et à terme de leur revenu… donc de leur capacité à produire des contenus de qualité.
Des questions, qui traversent la Communauté TMNlab depuis longtemps, se précisent. Dans ce contexte critique, la tentation du rejet numérique, de l’opposition du vivant au virtuel, est légitime. Mais si le lieu « vivant » peut (et doit ?) être un laboratoire de l’écologie de l’attention, un espace de sociabilité préservé des algorithmes, une agora pour la nuance et le débat, notre responsabilité dans une société numérique n’en est pas moins réelle. Les institutions culturelles peuvent-elles incarner un rôle de tiers de confiance dans cette écosystème connecté ? Une politique ambitieuse pour la découvrabilité des arts et de la culture peut-elle garantir la diversité culturelle face à un régime algorithmique qui tend à l’homogénéisation ? Comment développer la littératie numérique comme compétence culturelle fondamentale ? Quels nouveaux métiers et quelles nouvelles médiations cela implique-t-il pour les professionnels du spectacle vivant ?
Nous en parlons régulièrement, mais le sujet devient urgence.
Alors, pour poursuivre ce travail, quelques ressources et rendez-vous :
- Cycle de conférences (et travaux en général) du Centre Internet et société : Internet est-il (encore) un réseau de confiance ? du 9 octobre 2025 au 11 juin 2026 – sujet de la fameuse publication d’Olivier Alexandre ce mercredi 1er octobre sur LinkedIn
- Olivier Alexandre : « Big Data, Big Boss, Big Tech », les trois philosophies de la Tech, Vers un internet plein de vide ? et l’ensemble des publications de Hubert Guillaud sur l’excellent Dans les algorithmes
- Le Code a changé – Série Humains-machines : nos langues entremêlées, deux épisodes du formidable podcast de Xavier de La Porte sur France Inter
- Ouvrir le code des algorithmes ne suffit plus Par Olivier Ertzscheid, Chercheur en sciences de l’information et de la communication, dans la revue AOC
- ChatGPT ou la question de l’autorité dans la Revue européenne des médias et du numérique
- Pour un numérique émancipateur, durable et désirable par l’Association Designers Ethiques
- Ils ont volé internet : Cory Doctorow appelle à la destruction des Big Tech sur Actualitté, le livre Le rapt d’Internet du même Cory Doctorow et son intervention filée (en anglais) ci-dessous
A suivre.
—
Cet article a été écrit sans IA – sauf pour de l’analyse de rapports à la recherche de sources… – et l’image d’illustration a été créée sur Paint, en faible résolution et avec la police reine du web des années 90 et cauchemar des DA, Comic sans MS. D’ailleurs, si vous cherchez Comic Sans MS sur Google pour en savoir plus, vous aurez le droit à une blague de geek.